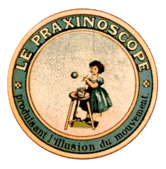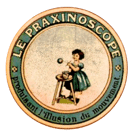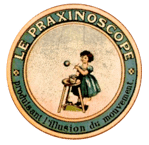Constructeur de praxinoscopes
Jean-Noël Felix
A quelle occasion avez-vous eu connaissance des travaux d'Émile Reynaud?
Autant qu’il m’en souvienne, je me suis toujours intéressé au pré-cinéma, à la façon dont il était possible de faire “bouger” des images. Les hasards de la vie ont fait que j’ai pu intégrer, en 1984, le Service des Archives du film du CNC, où j'ai eu la chance de côtoyer Julien Pappé qui travaillait à reproduire les deux bandes existantes du Théâtre optique pour les proposer à un plus large public.
Quel rôle avez-vous joué dans ce projet?
Aucun. On m'avait engagé comme chimiste (j'avais fait des études de biochimie, ce qui n'avait rien à voir.….). Mon boulot consistait à prélever des pastilles sur des films anciens afin d’analyser, et si possible de ralentir, le vieillissement de la pellicule. Ça fait déjà 40 ans. ce n’est plus très clair dans ma mémoire ; les Archives du film étaient en pleine réorganisation, du coup , on allait de service en service, et j’ai pu rester dans celui qui m’intéressait le plus, même si je ne comprenais pas vraiment en quoi consistait le travail de Julien Pappé.
Je me souviens, par contre, d’avoir eu accès aux collections des appareils détenus à Bois d’Arcy, et d’avoir participé à leur catalogage sous la houlette d’André Dyja qui dirigeait cette section du CNC.
J'y retournerai 10 ans plus tard à l’occasion d’une exposition organisée pour le centenaire du cinéma...
A quel moment vous est venue l’idée de construire vous-même des jouets d’optique, et en particulier, des praxinoscopes ?
J’avais dû lire, quelque part, le récit du premier praxinoscope fabriqué par Émile Reynaud lui-même, dans une boîte à gâteaux, et destiné au fils de sa femme de ménage au Puy-en-Velay. Même s’il y a, sans doute, une part de légende dans cette histoire, apprendre que l'objet qui allait permettre l'animation des toutes premières images, avait été conçu de la sorte m'avait beaucoup touché.
Après mon passage aux Archives du film, j’ai été engagé par la société Argos Film où travaillait le réalisateur Chris Marker, qui s’intéressait de près à l’animation et au pré-cinéma, même si ses travaux portaient plutôt sur le tout début de la numérisation des images.
Nous avons cherché à construire un praxinoscope dont il pourrait filmer et retravailler les images.Grâce à ses conseils, j’ai continué à en fabriquer en cherchant à me rapprocher le plus possible de l'original, jusqu’à maintenant...
Quels autres jouets d'optique construisez-vous ?
J'essaie modestement de reproduire la plupart des jouets d’optique qui ont contribué à l’avènement du cinématographe (thaumatropes, phénakistiscopes, zootropes, praxinoscopes, praxinoscopes-jouet, praxinoscopes-théâtre, etc).
Avec l’aide de Sylvie et Hubert Saerens, j’ai pu réunir (et restaurer) les 30 bandes du praxinoscope et les 20 bandes du praxinoscope-théâtre.
Il m'a fallu aussi retrouver et dupliquer (avec l’aide de François Binétruy) les 10 disques de la toupie fantoches.
Il y a encore du travail pour rassembler tous les disques du fantascope et du phénakistiscope…
Quels sont les problèmes techniques auxquels vous avez été confrontés pour construire les premiers praxinoscopes?
Les premiers, et les récents aussi. Je suis toujours à la recherche d’améliorations pour les rendre encore plus fiables. Mon but est simplement d’en faire la démonstration auprès du public, et de les rendre accessibles au plus grand nombre tout en me rapprochant le plus possible de l’appareil conçu par Émile Reynaud.
Une fois résolus les problèmes techniques, les contraintes sont plutôt d’ordre financier. Reproduire le cylindre en laiton, comme à l’époque, est pratiquement impossible aujourd’hui en raison d’un coût excessif.
J’ai dû faire fabriquer des boîtes en fer blanc de mêmes dimensions, et je les repeins dans les couleurs les plus proches de l’original.
Le prisme à facettes est fabriqué à partir de miroirs découpés et collés sur un dodécagone (douze côtés). Le principal changement tient au mécanisme qui fait tourner l’appareil ; j’utilise un roulement à billes qui stabilise le cylindre et le fait tourner plus longtemps.
Le pied est en bois tourné, comme à l’époque, s’approchant au plus près du modèle d’origine.
L’abat-jour est une réplique de l’original dupliqué sur carton ou sur toile/canevas (plus résistante à la chaleur).
L’étiquette (ER) est, elle aussi, dupliquée à partir d’une étiquette originale.
L’autre changement majeur, c’est bien sûr qu’il est difficile aujourd’hui de commercialiser des praxinoscopes avec une bougie comme source de lumière.
Je propose donc un modèle électrifié avec une ampoule (25 watts) en guise d’éclairage (ce qui en fait aussi une jolie lampe de chevet pour les enfants !).
Vous êtes venu prendre les mesures exactes de notre praxinoscope-théâtre afin d’en reconstruire un. Nous avons eu la chance de le voir presque terminé lors de la dernière Assemblée générale.
En effet, je manque un peu de savoir-faire et je tâtonne encore pour finaliser le praxinoscope-théâtre. J'ai pu me rendre compte de la complexité de l’appareil et des difficultés auxquelles a dû être confronté Émile Reynaud.
La boîte tout d’abord, à l’origine en acajou, qu’il est difficile (et cher) de trouver aujourd’hui ; puis tous les éléments constituant l’appareil : les plaques de décors, la plaque rideau, les guides, les charnières, l’inclinaison du miroir (sans doute un miroir sans tain à l’époque), etc...
Et en plus, tout doit pouvoir se ranger dans la boîte fermée, et ce n’est pas évident du tout...
Ce qui m’intéressait avant tout, c’était d'essayer de comprendre ce qui a motivé l’inventeur à vouloir animer ses images sur des décors interchangeables ; et d'y parvenir; c’est magique.
Quand nous sommes venus chez vous, j’ai cru me retrouver dans l’atelier d'Emile Reynaud... enfin, disons que je l’imagine très proche du vôtre.
Je n’y avais jamais pensé, mais ça me touche beaucoup.
La grande différence, c’est que je n’y invente rien ; j’essaie juste de reproduire, avec mes moyens, les inventions des précurseurs du cinéma.
C’est assez fascinant de pouvoir se replonger dans cet univers et c’est vrai que disposer d’un atelier, ça aide.
J'y pense aussi quand je reçois les éléments qui composent les appareils, quand il faut les assembler, les coller, les tester. on essaie ; tout n’est pas parfait, on jette aussi quelquefois.
Avez-vous des projets de construction d’autres appareils ?
Je m’essaye actuellement au praxinoscope à manivelle. ça reste très ingénieux et pas simple à reproduire.
Il y a aussi le praxinoscope à moteur, le praxinoscope musical, le zoopraxinoscope… même le praxinoscope à énergie solaire. on y pense !
Vous avez travaillé deux décennies pour Agnès Varda.
Connaissait-elle les travaux d’Émile Reynaud ?
Oui: elle était aussi photographe et s’intéressait avant tout aux images ; elle était curieuse de tout ce qui avait précédé le cinématographe.
Elle nous avait accompagné à la dernière édition des Cinglés du Cinéma à Argenteuil pour faire des photos avec les praxinoscopes.
Elle m’en a souvent commandé, mais je ne pouvais que les lui offrir.
Elle m’a fait découvrir les travaux de Jacques Demy qui, avant même de faire des films, et au même titre qu'Émile Reynaud, dessinait des saynètes directement sur des films perforés.
Nous en avons retrouvé quelques-unes, mais on n’a pas su s’il avait pu les projeter. En tout cas, ces images existent bien sur DVD.
Je crois que vous avez aussi présenté une exposition sur le pré-cinéma à l’occasion du centenaire de l'invention des Frères Lumière.
Exact, à travers une petite structure de distribution que nous avions créée, nous avons présenté une exposition itinérante intitulée Le Cinéma des Origines qui reprenait les différentes étapes ayant conduit à la naissance du cinéma.
Elle a circulé dans de nombreuses villes à partir de décembre 1995, cent ans après la première projection publique des frères Lumière.
Nous avons eu accès au matériel déposé au Service des Archives du film, à l’Institut Lumière (grâce à Bertrand Tavernier), et à la collection du producteur Pierre Braunberger (par l’intermédiaire de sa fille Laurence).
Cette exposition, parrainée par Pierre Tchernia, a été inaugurée au cinéma l’Arlequin à Paris. Raymond Depardon, dont nous distribuions les films, présentait en parallèle sa vision du pré-cinéma à travers des clichés originaux.
Avez-vous une idée du nombre de praxinoscopes vendus, et dans quels pays ?
Bien moins qu'Émile Reynaud, sans doute.
Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de manifestations où présenter nos reproductions, la plupart des brocantes photo/cinéma disparaissent peu à peu.
Cela permettait pourtant de présenter ces appareils, encore trop peu connus, au grand public; et aussi de les proposer à des prix abordables.
On les propose aussi aujourd’hui sur les sites de e-commerce.
Étonnamment, ça suscite de l’intérêt dans de nombreux pays, principalement dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, et même en Australie et en Ukraine !
Il y a encore peu de concurrence dans ce domaine. Il s’en fabrique en Hongrie, en Espagne. tous de bonne qualité mais s’éloignant du praxinoscope original.
Il y a aussi d'excellents artisans français qui s’évertuent à fabriquer des praxinoscopes à l’identique.
Une dernière réflexion proposée par Jean-Noël lui-même :
Pourquoi a- t-on cherché (et réussi) à animer des images ?
Vaste sujet. Vouloir représenter quelque chose de la réalité semble avoir toujours été un défi pour les Homo sapiens que nous sommes.
D'abord à travers la gravure, le dessin, puis la peinture, la sculpture; et plus tard grâce à la photographie...
Mais qui donc a cherché, en premier, à animer des images ?
Peut-être que la réponse est à trouver dans les grottes ornées des Magdaléniens où la répétition et la surcharge des animaux représentés peut laisser à penser qu’ils cherchaient, à la lumière de leur lampe à graisse, à donner l'illusion du mouvement.
Ce domaine reste à explorer, mais de nombreux arguments vont, aujourd’hui, dans ce sens.
Bien plus tard, les théâtres d’ombres, les plaques animées des lanternes magiques contribueront à rendre possible cette volonté de faire bouger des images.
Cela deviendra réalité avec le phénakistiscope, puis ses dérivés, dont le praxinoscope, où une image se substitue à une autre pour nous faire entrevoir une courte scène animée.
Aujourd’hui, c’est avec l’IA qu’on va parvenir à animer des images/photos qui n’existent tout simplement pas.
C’est un monde qui nous échappe encore presque totalement; peut-être comparable à ce qui a été ressenti lors des premières tentatives d’animations apparues au cours du XIXème siècle.
Personne ne soupçonnait à l’époque ce que ça allait devenir...